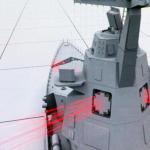La théocratie comme forme de pouvoir - exemples d'États théocratiques. Théocratie Théocratie du pouvoir
Soloviev est un idéaliste. Comme Platon, il estime que l'essentiel est une bonne idée. Et une bonne idée ne peut que faire son chemin dans la vie. Platon a failli devenir victime de son idéalisme lorsqu'il a failli être vendu comme esclave. Soloviev n'a pas été vendu comme esclave, mais vers la fin de sa vie, il s'est lui-même rendu compte qu'une idée, si elle s'écarte de l'intérêt matériel, se déshonore elle-même. Son idée d'une théocratie universelle s'est avérée aussi utopique que le communisme de Platon.
Soloviev se veut progressiste et humaniste, mais il nie la voie de la violence révolutionnaire. Il nie, pour ainsi dire, à la fois l’intérêt matériel et l’idée libérale d’harmonie des « intérêts ». Mais ceux qui ne s’appuient pas sur des transformations révolutionnaires venues d’en bas font appel aux « sommets » et nient l’idée de démocratie en général. C'est exactement ce qui s'est passé avec Soloviev, qui, progressiste et humaniste dans l'air du temps, s'est perdu dans sa quête et, à la fin de sa vie, ne comptait que sur Dieu. Et il a commencé dans l’espoir de la bonne volonté du peuple et des autorités.
« La conviction consciente, écrit Soloviev, que l'état actuel de l'humanité n'est pas ce qu'il devrait être, signifie pour moi qu'il doit être changé, transformé... Conscient de la nécessité d'une transformation, je m'engage ainsi à consacrer toute ma la vie et toutes leurs forces pour que cette transformation s'accomplisse véritablement. Mais la question la plus importante : où sont les moyens ?.. Je sais que toute transformation doit se faire de l'intérieur, de l'esprit et du cœur de l'homme. Les gens sont contrôlés par leurs croyances, vous devez donc agir en fonction de vos croyances, convaincre les gens de la vérité. La vérité elle-même, c'est-à-dire le christianisme... - la vérité en elle-même est claire dans ma conscience, mais la question est de savoir comment l'introduire dans la conscience universelle, pour laquelle elle est actuellement une sorte de monstrum, quelque chose de complètement étranger et incompréhensible ... ". Pourquoi la vérité du christianisme s’avère-t-elle encore incompréhensible et étrangère aux gens ?
130 Soloviev B.S. Collection Op. Lettres et pièces jointes. T.Z. Bruxelles, 1970. pp. 88-89.
Si vous essayez de répondre à cette question, comme, en général, Soloviev lui-même y répond, alors la conclusion est la suivante : le christianisme s'est éloigné de l'idée de progrès social. Et cela s'applique avant tout au christianisme orthodoxe. Le catholicisme, dans une certaine mesure, a réussi à « mettre en selle » l’idée de progrès social. L'Église catholique reconnaît les droits de l'homme et les droits civils. D’où certaines sympathies de Soloviev pour le catholicisme, tout comme Tchaadaev en son temps.
Soloviev fait la distinction entre le christianisme par essence et le christianisme historique, c'est-à-dire la forme de sa manifestation. Et c'est précisément la forme du christianisme, selon Soloviev, qui est fausse et ne correspond pas à son contenu. Bien entendu, la tâche est de mettre tout cela en conformité. « La question est tout d'abord, pose Soloviev, qu'est-ce qui cause cette aliénation de l'esprit moderne du christianisme ? Il serait très facile de tout imputer à l'erreur humaine ou à l'ignorance, mais c'est tout aussi frivole... Le fait est que le christianisme, bien que certainement vrai en lui-même, n'a eu jusqu'à présent, en raison des conditions historiques, qu'un seul expression biaisée et insuffisante.
À l’exception de quelques esprits sélectionnés, pour la majorité, le christianisme n’était qu’une simple question de foi à moitié consciente et de sentiments vagues, mais il ne parlait rien à l’esprit, n’entrait pas dans l’esprit. En conséquence, il était enfermé dans une forme déraisonnable qui ne lui correspondait pas et était encombré de toutes sortes de détritus dénués de sens... La tâche à venir était d'introduire le contenu éternel du christianisme dans une nouvelle forme qui lui correspond, c'est-à-dire , une forme inconditionnellement raisonnable. Pour ce faire, il faut profiter de tout ce qui a été développé par l'esprit humain au cours des siècles passés : il faut assimiler les résultats généraux du développement scientifique, il faut étudier toute la philosophie. C’est ce que je fais et je continuerai de le faire… »
131 Soloviev B.S. Décret. Op.
A noter que, contrairement aux slavophiles et aux occidentaux, Soloviev n'idéalise pas l'une des formes de conscience religieuse - occidentale ou orientale. Selon lui, les peuples occidentaux glorifient « l’homme impie » et les peuples orientaux glorifient le « Dieu inhumain ». Il n’oppose donc pas l’orthodoxie au catholicisme, mais prône une synthèse entre eux.
Dans l'ensemble, le christianisme pour Soloviev n'est pas seulement une religion, une foi, un culte, mais pour lui c'est une idée, une doctrine sociale qui doit être alignée sur la forme de son expression et mise en œuvre dans la vie. Pour lui, cela équivaut aux idées du christianisme primitif, sous l’influence desquelles le mouvement de Réforme s’est développé en Europe.
Le projet qui est venu à l'esprit de Soloviev, vingt ans, aurait pu se réaliser, comme le note P.A. Sapronov, dans une tête pas tout à fait saine. « Il faut imaginer, écrit-il, dans toute sa clarté immuable, qu'un jeune de vingt ans avait l'intention non seulement de faire de la foi une raison, de l'idée un concept, de subordonner la religion à la philosophie ou à quelque autre connaissance globale, mais il il avait également pour objectif de transformer le christianisme lui-même et, avec lui et l'humanité, de faire enfin ce que son Fondateur et ses apôtres ont échoué (cela se passe exactement ainsi). La formulation d’une telle tâche aurait pu relever de la folie, de la folie des grandeurs, si Soloviev avait été religieusement sain d’esprit. Cependant, la raison philosophique de Soloviev est également remise en question.»
132 Sapronov P.A. Philosophie russe. Expérience des caractéristiques typologiques. Saint-Pétersbourg, 2000. pp. 110-111.
Que propose exactement Soloviev ? Premièrement, unir toutes les Églises chrétiennes, et surtout catholiques et orthodoxes. Deuxièmement, combiner le pouvoir séculier avec le pouvoir spirituel. Platon, en tant que réformateur social, fit appel au tyran Denys. Le prophète Mahomet lui-même a dû se mettre à la tête du peuple armé pour introduire non seulement une nouvelle religion, mais aussi de nouveaux ordres sociaux. Et le califat arabe est devenu la première théocratie de l’histoire.
Comte, en tant que réformateur social, qui était également partisan d'une sorte de théocratie, a écrit au tsar-autocrate russe pour qu'il utilise son pouvoir pour transformer la société sur une « base raisonnable », et quand lui, en tant que personne intelligente, est resté silencieux , tourné avec une proposition similaire au Turc au sultan... Soloviev n'a pas échappé à cette logique : pour introduire des « principes raisonnables » dans la vie, un pouvoir illimité est nécessaire. Qui a un tel pouvoir ? - Naturellement, le tsar russe et le pape. Mais comme on dit, Dieu aime la Trinité. La « théocratie universelle » de Soloviev ressemble donc finalement à ceci : le grand prêtre romain correspond à Dieu le Père, le roi chrétien à Dieu le Fils et le prophète philosophe à Dieu le Saint-Esprit (ici Soloviev veut apparemment dire lui-même).
Quant à l’objectif de la « théocratie universelle », il semble que celui de Soloviev soit le plus noble, c’est-à-dire le même qui est exprimé dans les mots de Schiller – « embrasser des millions » – et mis en musique par le grand Beethoven. C'est l'idée de la fraternité humaine universelle. L’« Église universelle » doit unir toutes les nations et tous les peuples de la Terre, éliminer l’égoïsme et l’inimitié entre eux et éliminer toutes les contradictions sociales. En d’autres termes, il s’agit du projet du Royaume de Dieu sur Terre, dont rêvaient (et rêvaient) les chrétiens, mais qui se conjugue ici avec les idées du socialisme et du communisme qui étaient à la mode au XIXe siècle. Et sous cette forme, il incarne l'idée de Dieu-virilité.
Mais en même temps, « l’humanité divine » de Soloviev rappelle douloureusement le « communisme » de Platon avec ses classes et une division claire des « fonctions » et des « pouvoirs ». La division de classes et la hiérarchie sociale dans la société « idéale » de Soloviev sont préservées. Et il parle précisément de trois - encore une fois, Dieu (et Hegel) aime une trinité - « classes principales » de la société : « le peuple au sens étroit - la classe rurale ou agricole d'abord, puis la classe urbaine et, enfin, la classe des meilleures personnes, personnalités publiques et dirigeants du peuple, indicateurs du chemin ; sinon : village, ville et escouade."
133 Soloviev B.S. Collection Op. en 10 volumes Saint-Pétersbourg, 1911-1914, T. 3. P. 413.
Marx a dit un jour que « l’état idéal » de Platon est une idéalisation du système des castes égyptien. Qu’idéalise Soloviev dans sa « théocratie universelle » ? Il est difficile de répondre définitivement à cette question. Mais la monarchie autocratique bourgeoise-propriétaire russe est ici clairement visible. Et ici on distingue O. Comte avec ses « meilleurs gens » et ses « sages patrons », auxquels il est si joyeux d'obéir. Ce n’est pas sans raison qu’en 1988, dans un rapport lu à l’occasion du centenaire de Comte, Soloviev exprime son accord avec les fondements de sa « religion positive ».
Le cours général de l’histoire humaine, selon Soloviev, est tel qu’il commence par une société tribale, puis évolue vers une forme d’État national et devrait se terminer par une forme universelle. La forme générique, cela se comprend. La forme « État-nation » est ce qu’on appelle la civilisation. Mais « universel » est déjà le communisme, le Royaume de Dieu sur terre ou, selon Soloviev, la théocratie universelle. « Le contenu moral de la vie tribale est éternel », écrit-il, « la forme limitée de la vie tribale est inévitablement dissoute par le processus historique avec la participation active de l'individu. »
Dans la philosophie de Soloviev, on peut discerner les contours de la philosophie de la « cause commune » de N. Fedorov : l’humanité ne peut s’unir que consciemment et uniquement pour une cause qui est importante pour tous. Dans le cas contraire, leur unification ne sera que formelle. « La tâche, écrit-il, n’est pas simplement d’unir toutes les parties de l’humanité et toutes les affaires humaines dans une cause commune. On peut imaginer que les gens travaillent ensemble à une grande tâche et y réduisent toutes leurs activités privées et les y subordonnent, mais si cette tâche leur est imposée, si pour eux elle est quelque chose de fatal et d'implacable, s'ils sont unis par des liens aveugles. instinct ou coercition extérieure, alors, même si une telle unité s’étendait à l’ensemble de l’humanité, elle ne serait pas une véritable pan-humanité, mais seulement une immense « fourmilière ». Nous savons que des exemples de telles fourmilières se trouvent dans les despotismes orientaux - en Chine, en Égypte et, à petite échelle, ils ont déjà été réalisés par les communistes en Amérique du Nord. Dostoïevski s'est rebellé de toutes ses forces contre une telle fourmilière, y voyant le contraire direct de son idéal social. Son idéal exige non seulement l’unité de tous les peuples et de toutes les affaires humaines, mais surtout leur unité humaine. Il ne s’agit pas d’unité, mais du libre consentement à l’unité. Il ne s’agit pas de la grandeur et de l’importance de la tâche commune, mais de sa reconnaissance volontaire.»
134 Soloviev B.S. Op. en 2 vol. M., 1990. T. 1. P. 289.
135 Idem. T. 2. P. 306.
Il est vrai qu’à la fin de sa vie, Soloviev a pris conscience de l’utopisme de sa « théocratie universelle ». Dans la préface de « Trois conversations sur la guerre, le progrès et la fin de l’histoire mondiale, y compris un bref récit de l’Antéchrist et des annexes », il écrit : « Les restrictions à la liberté religieuse qui nous restent sont l’un de mes plus grands chagrins. , parce que je vois et je sens combien toutes ces contraintes extérieures sont à la fois nuisibles et douloureuses, non seulement pour ceux qui y sont soumis, mais surtout pour la cause chrétienne en Russie, et par conséquent, pour le peuple russe, et par conséquent pour le peuple russe. État."
L'utopisme de Soloviev réside dans le fait que sa « théocratie universelle » est impliquée dans les idées du libéralisme, y compris l'idée de liberté religieuse. Mais excusez-moi, quel genre de liberté religieuse peut-il y avoir dans une théocratie ? Le christianisme, dès qu’il fut constitué en Église et devint la religion officielle de l’État romain, passa immédiatement du statut de persécuté à celui de persécuteur et de persécuteur de toutes les « hérésies ». La même chose s'est produite avec l'Islam. Et dans ce dernier cas, une véritable théocratie a émergé. Mais une théocratie n’est-elle pas un État où le roi est « l’oint » et où l’Église a été transformée en département d’État ?
Tout cela ne peut être considéré que comme une réaction à la montée de la démocratie en Russie. Et c’est de Soloviev que naît la critique de « l’amour du peuple », qui connaîtra son apogée dans la « Philosophie de l’inégalité » de Berdiaev. Soloviev trouve d’ailleurs chez Dostoïevski les origines de cette anti-démocratie. « Dostoïevski, écrit-il, n’a jamais idéalisé le peuple et ne l’a pas vénéré comme une idole ». Cela serait compréhensible si c’était dans l’esprit de « tu ne feras pas de toi une idole ». Mais Soloviev ne fait que ce qu'il veut créer pour lui-même : une idole de l'Église chrétienne. « Déjà dans « Démons », écrit Soloviev, « il y a une moquerie acerbe à l'égard de ces gens qui adorent le peuple uniquement parce qu'ils sont le peuple et valorisent l'orthodoxie comme un attribut de la nationalité russe. Si nous voulons désigner en un mot l'idéal social auquel Dostoïevski est parvenu, alors ce mot ne sera pas le peuple, mais l'Église.
136 Soloviev B.S. Décret. Op. P. 638.
137 Idem. P. 304.
138 Idem. P. 300.
En d’autres termes, l’Église est nécessaire pour « sauver » le peuple. Mais cela signifie aussi que le peuple lui-même ne peut pas être sauvé : ce peuple est pécheur, vicieux et ignoble. Et c’est une idée aussi ancienne que le christianisme lui-même, l’idée des « Pères de l’Église », qui fut l’une des premières défendues par le bienheureux Augustin.
Le projet de « théocratie universelle » est une concrétisation de l'idée de Dieu-virilité, dans laquelle Soloviev s'est engagé dans les années 80. Et d'une manière générale, c'est l'idée de l'histoire du monde comme une sorte d'ascension. Et le but d’une telle ascension n’est pas une personne individuelle parfaite, mais un certain « organisme entièrement humain ». Ici, rappelons-le encore une fois, on sent l'influence sur Soloviev de Comte, pour qui l'humanité, et non l'homme, est la vraie réalité, atteignant l'état d'absolu par le progrès universel.
La différence, cependant, est que « l’organisme entièrement humain » de Soloviev est à la fois quelque chose de matériel et d’idéal. Ici encore se manifestent sa dialectique mystique et son désir de tout rassembler. En comparant Soloviev avec les représentants des classiques allemands, il faut dire que, identifiant directement l'idéal au matériel dans l'idéal de la virilité divine, il continue de suivre Schelling par opposition à Hegel, pour qui le lien entre l'idéal et le matériel est toujours médiatisé, notamment par le processus de développement. C’est à cela que sont liées les principales difficultés d’interprétation de l’idéal de Soloviev, où tout converge avec tout le reste, mais on ne sait pas comment.
Il faut dire que dans le Christ comme but du développement humain, Soloviev combine le Logos comme principe masculin et Sophia (le corps du Christ) comme principe féminin. Et ici, nous ne pouvons ignorer le thème du genre, qui joue un rôle important dans les enseignements de Soloviev, conformément aux sentiments de son époque. « Ici, écrit Soloviev à propos du corps et du genre, il y a une grande contradiction, une antinomie fatale, qu'il faut en tout cas reconnaître, même si nous n'avions aucun espoir de la résoudre. La procréation est bonne ; c'est bon pour la mère qui, selon la parole de l'Apôtre, est sauvée par l'accouchement, et, bien sûr, bon aussi pour le père qui participe à cette œuvre salvifique, bon enfin pour ceux qui reçoivent le don de la vie . Et en même temps, il est aussi indéniable qu’il y a du mal dans la reproduction charnelle… »
139 Soloviev B.S. Op. en 2 vol. M., 1990. T. 1. P. 228.
L'incohérence indiquée par Soloviev n'est pas accidentelle. Il exprime la position instable de l’Orthodoxie réformée, dont il y avait deux voies à la fin du XIXe siècle. Une voie est celle du panthéisme, du déisme, du luthéranisme, c'est-à-dire de la Réforme et, finalement, de l'athéisme. L’autre voie est le retour au paganisme. La deuxième voie supposait le salut du christianisme en raison de sa perte partielle de lui-même, et surtout de la perte de l'ascèse purement chrétienne avec son mépris du corps et du genre. Il est clair que dans des conditions où tous veulent avoir les deux, rester fidèles aux alliances de saint Paul. les pères et les apôtres n’est plus possible.
En décrivant la solution proposée par Soloviev au problème du genre, il convient de rappeler que les préoccupations sexuelles se sont propagées presque comme une épidémie au sein de l’intelligentsia russe. C'est un signe des temps où, au début du XXe siècle, en Russie, tout le monde voulait un « corps ». Et tout cela s'est produit dans le contexte de la perte des valeurs morales traditionnelles sanctifiées par le christianisme. Par conséquent, le presque saint V. Soloviev s'intéresse à Sophie non seulement en tant que Sagesse, mais aussi en tant que femme. Et toute l’œuvre de V. Rozanov tourne autour de cela. Qu'ont fait D. Merezhkovsky et 3. Gippius ? Ils s’intéressaient à la bestialité païenne, encore une fois sacrée. Et c’est là, pourrait-on dire, toute la culture, ou plutôt la contre-culture de ce qu’on appelle « l’âge d’argent ».
Mais il faut encore voir la différence entre Merezhkovsky et Gippius et leur prédécesseur Soloviev, chez qui l'apothéose de la passion sexuelle dans son traité « Le sens de l'amour » se conjugue avec une ascèse extrême. Pas étonnant que K.V. Mochulsky notait à cette occasion : « L’amour doit être sexuel, mais en même temps éthéré. » Ce genre d’Eros idéal, selon Solovyov, est précisément ce qui devrait transformer notre physicalité.
140 Mochulsky K.V. Gogol, Soloviev, Dostoïevski. M., 1955. P. 180.
La théurgie de Soloviev, qui transforme notre physique, ainsi que tout son enseignement sur la virilité divine, ont leurs moments choquants. Par exemple, la pensée de la future réunion de l'homme et de la femme en androgyne comme une sorte d'être bisexuel, dans lequel l'idéal prévaudra sur le matériel. Pour les gens ordinaires, une personne bisexuelle est un monstre, mais pour Soloviev, c'est le rêve ultime et la transition vers l'Homme-Dieu. Ceci, bien sûr, exprime l'émeute de l'imagination et « davantage l'exaltation de sa nature ». Mais, réceptif aux innovations, Soloviev restait toujours un homme de l'époque classique, dévoué de manière désintéressée à l'idéal.
Il est désormais clair que toute la philosophie religieuse de « l’âge d’argent » est venue de Soloviev et de Dostoïevski, comme la littérature russe du « Pardessus » de Gogol. Mais ils sont allés, avec toutes leurs déclarations subjectives, dans la direction opposée, du christianisme au gnosticisme, au zoroastrisme, au judaïsme, etc. De plus, leur recherche du « Troisième Testament » et de la « nouvelle conscience religieuse » ne peut être comprise sans le nietzschéisme.
Le développement de la sophiologie de Soloviev, des idées d'unité totale et de virilité divine au début du 20e siècle a été réalisé par D. Merezhkovsky, L. Karsavin, S. Frank, P. Florensky, S. Boulgakov, N. Berdiaev. , L. Chestov et autres. Nous nous concentrerons sur les travaux des deux derniers, dans lesquels l'interdépendance de la philosophie russe et européenne au XXe siècle est le plus clairement visible.
- Théocratie
Théocratie(du grec θεος - Dieu et κρατειν - gouverner) - un système de gouvernement dans lequel les affaires publiques importantes sont décidées selon des instructions, des révélations ou des lois divines. Selon une autre définition, un système politique dans lequel les personnalités religieuses ont une influence décisive sur la politique de l'État.
Histoire
Comme le décrit Hérodote (Histoire 2 : 52), le concept de « Dieu » (θεος) a été formulé parmi les tribus proto-grecques des Pélasges : « Autrefois, comme je l'ai appris à Dodone, les Pélasges faisaient des sacrifices aux dieux, offrant des prières, mais n'invoquant pas les noms de dieux individuels. Après tout, ils ne connaissaient pas encore les noms des dieux. Les Pélasges leur ont donné le nom de « dieux » (θεοi) parce que les dieux établissaient (θεντες) l'ordre du monde et distribuaient tous les biens selon leur volonté.
Ainsi, selon Hérodote, la théocratie vise à suivre l’ordre mondial pour établir l’harmonie (un état parfait) dans la société. Le rituel du sacrifice lui-même était destiné à déterminer la volonté des dieux en fonction de l'état de la victime, et a ensuite commencé à être compris comme une offrande à Dieu, dans le but de l'incliner à la miséricorde. Les racines de la théocratie se perdent dans les profondeurs de l'histoire : on sait que dans les États anciens (en Égypte, en Mésopotamie, au Mexique et ailleurs), les dirigeants étaient des prêtres et décidaient des affaires selon leurs croyances religieuses, ou se proclamaient même dieux.
Un exemple de théocratie est donné par la Bible (le livre des Juges et les livres de Samuel - dans la traduction synodale russe de 1 et 2 Livres des Rois), qui décrit qu'au début de la formation de l'État juif, leur la société était gouvernée par des juges à qui Dieu révélait sa volonté. Dans le même but, les prêtres utilisaient un lot spécial : Urim (clair) et tumim (sombre) - apparemment, c'étaient quelque chose comme des pierres qui se trouvaient dans un sac spécial avec le grand prêtre. Le processus de découverte de la volonté de Dieu consistait à formuler clairement une question au grand prêtre, qui ne devait avoir que deux réponses claires : oui ou non. Le prêtre a prié Dieu et a sorti du sac la pierre nécessaire - on croyait que Dieu lui-même guidait sa main. Urim signifiait « oui » et tumim « non ». Selon une autre version, l'une des pierres aurait commencé à briller entre les mains du grand prêtre.
Des exemples d'autres dessins sont décrits à d'autres endroits de la Bible : par exemple, Abraham s'interrogeait sur l'avenir en étalant sur l'autel les corps découpés d'animaux, et par leur combustion spontanée, il réalisa que ses descendants étaient destinés à régner sur Canaan (Gen. . 15 : 8-18), et pendant l'exode, les Juifs tirèrent au sort qui devait être grand prêtre, plaçant des bâtons de bois devant le sanctuaire, et reconnurent le digne au fait que son bâton produisait des bourgeons (Nombres 17 : 8-18). 2-8).
Les exemples tirés de la Bible ne reflètent que la compréhension historiquement déterminée et plutôt limitée de la théocratie par les auteurs de ce livre.
La théocratie était la base du gouvernement pour tous. source non précisée 179 jours] États développés de l’Antiquité (d’autres ont tout simplement disparu et nous n’en savons rien). Ainsi, tous les anciens pharaons d'Égypte étaient des prêtres et se proclamaient dieux ou fils de dieux ; dans la Grèce antique, les décisions étaient souvent prises sur la base des prophéties des oracles (objets spéciaux, phénomènes dans lesquels étaient expliqués des interprètes spéciaux - prêtres ou prêtresses) et les cercles dirigeants envoyaient des ambassades spéciales auprès des oracles ( théorie), ainsi que sur la base de la bonne aventure et des prophéties de leurs propres prophètes. L'ancienne République romaine était la même théocratie [ source non précisée 179 jours], dans laquelle les plus hauts fonctionnaires (consuls et autres) étaient simultanément prêtres et avaient le devoir de faire des sacrifices [ source non précisée 179 jours], en déterminant le meilleur plan d'action de leur part. Des éléments de théocratie étaient également présents plus tard - au Moyen Âge et à l'époque moderne, lorsque les joutes et les duels étaient choisis comme méthode de résolution des différends (parfois cela prenait la forme d'un jeu, par exemple de dés ou de cartes), ou simplement en tirant au sort - on croyait que Dieu lui-même était du côté des gagnants, c'est-à-dire que sa victoire servait le bien commun. L’existence de théocraties dans l’Antiquité ne constitue cependant pas une preuve de leur nécessité ou de leur bénéfice pour la société moderne. Au contraire, la compréhension moderne de la théocratie part du fait qu'une telle forme de gouvernement contredit les principes du pluralisme religieux, de la démocratie et des principes moraux de la société moderne.
Josèphe Flavius a été le premier à utiliser le terme théocratie dans ses écrits. Il a écrit que si pour les Grecs il n’existe que trois formes de gouvernement (aristocratie, monarchie et anarchie), les Juifs ont développé un système différent qui n’entre dans aucune des catégories grecques.
La théocratie dans le christianisme
On sait que les premiers chrétiens (et jusqu'à la fin du VIIe siècle) utilisaient largement la divination tirée de la Bible (notamment du livre des Psaumes) : le livre était ouvert au hasard, et selon le sens du premier mot de la page (ou un mot choisi au hasard), une prédiction a été faite sur le succès ou le résultat de l'action entreprise ou des événements.
La base raisonnable de la théocratie est la croyance que Dieu arrange le monde pour le bien, et donc les actions qui correspondent à la providence de Dieu sont les plus favorables et les plus prudentes, et vice versa : celles qui les contredisent sont désastreuses. Par conséquent, dans les temps anciens, les gens croyaient qu'il était plus prudent d'agir non pas selon leur propre esprit, mais de coordonner leurs actions avec la volonté de Dieu.
Cependant, comme le montre l'histoire, ayant ainsi atteint une certaine prospérité, les gens se sont corrompus et, poussés par leurs instincts charnels (ou, selon d'autres vues, tombant sous le pouvoir de Satan), se sont éloignés d'un tel système théocratique, le remplaçant par divers des actes de charlatan qui servaient de couverture à leur mise en œuvre de convoitises avides. Les prêtres, comme le décrit par exemple la Bible, exigeaient que les sacrifices soient faits uniquement sous leur contrôle et dans leurs temples, où ils pouvaient donner aux actions sacrificielles les interprétations qui leur plaisaient et recevoir un pot-de-vin pour cela ; la grande demande de vérification de la volonté de Dieu a donné naissance à de nombreux sorciers et sorciers qui utilisent diverses techniques frauduleuses pour s'enrichir ; les personnes au pouvoir ont commencé à utiliser des techniques similaires pour affirmer et renforcer leur position. Tout cela a été réalisé à l'aide d'actions qui imitent la divination, mais ne le sont pas en substance. Ainsi, les Jésuites ont inventé, par exemple, cette méthode pour déterminer s'ils appartiennent à une sorcière : une femme qu'ils soupçonnaient était ligotée et jetée à l'eau, en disant que si elle nage, alors Dieu indique qu'elle est une sorcière. sorcière, et si elle ne nage pas, ce n'est pas une sorcière. Dans une telle « méthode », la volonté de Dieu ne peut en aucun cas se manifester, puisqu’elle ne se manifeste que là où il existe une liberté d’expression appropriée pour sa manifestation (comme, par exemple, dans la divination avec l’Urim et le Thumim). En utilisant de telles techniques, certains ont obtenu des avantages apparents pour eux-mêmes et la réalisation de leurs désirs, et en conséquence, le gouvernement théocratique a été remplacé par le volontarisme égoïste des individus. La théocratie a dégénéré en une oligarchie ou un clergé (dont des exemples peuvent être trouvés dans le Sanhédrin hébreu, dans le Vatican et l'Iran modernes), qui s'est inévitablement transformée en monarchie (des exemples sont les pharaons égyptiens et les rois hébreux, les dirigeants des Aztèques et des Incas, et bien d’autres cas, dont l’empire romain). Poussée par des contradictions internes et une incohérence avec la providence de Dieu, la monarchie s'est inévitablement décomposée et, à travers les extrêmes de l'ochlocratie, la démocratie a surgi sur ses ruines - comme l'une des formes de théocratie dans laquelle la volonté de Dieu se manifeste dans l'opinion commune. du peuple (comme en témoigne le proverbe « la voix du peuple est la voix de Dieu »), sous la forme d'une république ou d'un gouvernement présidentiel, dans lequel la volonté de Dieu n'est pas explicitement révélée par des signes et des divinations. , mais indirectement à travers l’opinion publique des citoyens. Tout est revenu à la normale et a continué en cercle.
Le terme « théocratie » a été utilisé pour la première fois par un historien romain d'origine juive au 1er siècle après JC. Il a utilisé ce mot dans son ouvrage Contre Appion, où il s'est disputé avec le célèbre grammairien de l'époque. Bien que Flavius était un citoyen romain et ait même pris son nom de famille en l'honneur de l'empereur, il ne connaissait que le grec, dans lequel il écrivait ses œuvres.
D’où les racines étymologiques du terme. La première moitié du mot est traduite par « Dieu », la seconde par « gouverner ». Ainsi, nous pouvons conclure que la théocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le dirigeant suprême détient à la fois le pouvoir étatique et le pouvoir religieux.
Dispositions de base
Souvent, le dirigeant se voit attribuer le statut de vice-roi de Dieu sur le territoire qu'il gouverne. Mais ce n'est pas la seule définition. Une autre interprétation du terme implique que la personne suprême est Dieu lui-même.
La théocratie est une manière de la société ancienne puis médiévale d'expliquer l'univers. La religion jouait un rôle important dans les opinions de chaque nation. C'était si important qu'aucun pouvoir n'était considéré comme légitime à moins qu'il ne soit conféré par un dieu ou un panthéon de divinités dans le cas des païens.
Théocratie, cléricalisme et laïcité
Le concept de théocratie est étroitement lié au cléricalisme. Il s'agit d'un mouvement politique au sein de l'État qui cherche à renforcer les droits et l'importance du clergé. Dans l’ensemble, la théocratie est la forme la plus élevée du cléricalisme. Ce terme est plus souvent utilisé pour décrire la société moderne par opposition aux traditions qui existaient dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Aujourd'hui, le cléricalisme s'exerce non pas tant à travers des organisations religieuses (par exemple, des églises), mais à travers des instruments politiques - mouvements sociaux et partis.
A l’opposé de cette tendance, il existe un phénomène inverse : la laïcité. Selon ce concept, l’État et les organisations religieuses devraient exister séparément les uns des autres. Les principes de laïcité sont inscrits dans les lois et les constitutions de nombreux États laïcs où il n’y a pas de religion officielle. L’un des exemples les plus frappants et les plus significatifs de la mise en œuvre de ce concept s’est produit immédiatement après la révolution de 1917, lorsque les bolcheviks arrivés au pouvoir ont privé l’Église de ses biens et l’ont séparée de la bureaucratie. Le fondateur de l'idée de laïcité est considéré comme Épicure, qui, dans ses dénonciations philosophiques, s'est disputé avec les serviteurs du culte des anciens dieux grecs.
Exemples de théocraties
La première théocratie s’appelait l’État des Juifs, lorsque ce terme fut introduit par Josèphe pour décrire le pouvoir de son peuple. Cependant, chronologiquement, des monarchies à régime religieux existaient auparavant. C'était également le cas dans le royaume égyptien, où le titre de pharaon désignait le vice-roi de Dieu sur terre. Un principe similaire se retrouve dans l’Empire romain, où les empereurs étaient reconnus comme des dieux. La plupart d’entre eux sont des pays monarchiques. La liste est longue avec les califes islamiques, qui étaient également considérés comme les chefs de tous les musulmans sunnites.
théocratie islamique
Parmi les autres, la théocratie musulmane se distingue par une attention particulière portée à la mise en œuvre des lois divines. Les règles de la charia, inscrites dans le Coran, s’imposent à tous. Auparavant, ces États étaient appelés califats. La première d’entre elles a été fondée par le prophète Mahomet au VIIe siècle. Après quoi ses successeurs ont étendu le pouvoir de l’Islam à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et même l’Espagne.
Cependant, beaucoup de temps s’est écoulé depuis. Cependant, en Iran et en Arabie Saoudite, par exemple, tous les tribunaux reposent encore sur les lois du Coran. Les Perses sont chiites et leur chef religieux a plus de droits que le président. Il nomme par exemple de nombreux ministres influents, notamment ceux chargés de la défense de l’État.
En Arabie Saoudite, la forme politique de gouvernement est le successeur du califat. Le monarque l'a fait, et pour violation de la charia, une personne peut encourir la peine de mort.

Bouddhistes
Les experts débattent souvent de ce qu’est une théocratie. La définition a de nombreuses interprétations. L’un d’eux se reflète chez les bouddhistes. Un exemple est l’Organisation centrale tibétaine, qui copie en grande partie les caractéristiques de l’état précédent des moines tibétains. Depuis le milieu du XXe siècle, son administration est en exil suite à l'invasion de l'Armée populaire chinoise.
Cependant, le chef spirituel des bouddhistes tibétains, le Dalaï Lama, jouit d’une énorme autorité parmi ses fidèles dispersés à travers le monde. Les gens le considèrent comme l'incarnation de Dieu sur terre, ce qui rend ce système similaire au système islamique et à quelques autres.

À propos de la cité de Dieu
La tradition chrétienne a jeté les bases de la théocratie dans le traité « De la Cité de Dieu ». Il a été écrit au Ve siècle. théologien Aurèle Augustin. Et bien qu’il n’utilise pas le terme lui-même dans son œuvre, il décrit le même principe à partir de son propre exemple. Selon lui, la théocratie est la cité de Dieu, où toute vie est organisée selon la loi de l’Alliance.
Ses habitants ne violent pas les commandements et vivent en harmonie. En parallèle, il y a aussi la Ville Terrestre. Il est à l’opposé de son reflet divin. Les lois qui y sont établies sont déterminées par le peuple lui-même, qui, dans un accès d'orgueil, a décidé qu'il ne pouvait pas vivre selon la tradition chrétienne. En d’autres termes, ils ont renoncé à Dieu. Selon Augustin, selon le choix de la ville, une personne après sa mort sera jugée lors du Jugement dernier. Tous ceux qui renoncent aux lois célestes vont en enfer, tandis que ceux qui choisissent la cité de Dieu vont au ciel.
L'ouvrage a été écrit peu de temps après la prise et le pillage de Rome par les Goths, ce qui a renforcé les sentiments fatalistes de l'auteur. Là, Aurelius Augustin discute du pouvoir laïc. Elle est donnée par Dieu, ce qui signifie que les gens doivent lui obéir. Ce principe sera repris par les empereurs plusieurs siècles plus tard.

Vatican
La théocratie chrétienne moderne est le Vatican. C'est le plus petit État du monde. Elle est indépendante et gouvernée par le Pape, considéré comme le père spirituel de tous les catholiques.
Jusqu'en 1929, les États pontificaux ont pris la place, qui, dans ses meilleures années au XIXe siècle, occupait la moitié de l'Italie moderne. C'est une théocratie classique. L'autorité est considérée comme donnée par Dieu. La souveraineté sur le Vatican est déterminée par le Saint-Siège, qui appartient au Pape. En outre, il est également le chef de l’Église catholique.
Le pouvoir sur celui-ci n’est pas seulement légal, mais complet et indépendant de la volonté de chacun. Le pape est élu à vie par un conclave - une réunion des principaux cardinaux de l'Église. La procédure de sélection est établie depuis le XIIIe siècle.

Histoire de la papauté
Il s’agit d’un type d’ancienne forme de gouvernement. Un tableau décrivant la périodisation peut comprendre plusieurs étapes. Au début, ils étaient les chefs de communautés fermées, lorsque les chrétiens étaient persécutés par les Romains et adoraient leur dieu dans les profondeurs de la terre. Ce n’est qu’au IVe siècle que la religion fut reconnue et que le pape gagna en influence. Cependant, à cette époque, cela ne s’appliquait qu’au troupeau. Mais avec la chute du pouvoir laïc en Europe, l’institution des pontifes acquit une importance énorme, puisqu’elle était à cette époque le seul titre chrétien légitime. L'influence de la papauté s'est étendue à tous les pays d'Europe occidentale de la monarchie. La liste des rois considérés comme un échelon inférieur au pontife était longue - elle comprenait une douzaine de noms.
Il s’agissait de formes de gouvernement uniques. Les titres royaux étaient considérés comme inférieurs aux titres papaux. Les dirigeants européens ont obéi et écouté le Saint-Père, surtout lorsque des conflits surgissaient entre eux. Les papes étendirent l'influence de l'Église entière sur les territoires païens, appelant leurs rois à des croisades dont la plus célèbre se termina par la reconquête de Jérusalem.

La lutte pour les investitures et la Réforme
La situation actuelle du christianisme n’existe pas depuis très longtemps. Avant cela, le pouvoir des papes était contesté par de nombreux mouvements religieux et même par des dirigeants laïcs. Nous parlons ici principalement de la lutte pour l'investiture aux XIe et XIIe siècles.
Le problème concernait la forme de gouvernement d’alors. Un tableau de la société médiévale peut nous décrire plusieurs classes : les paysans, les marchands, les seigneurs féodaux. Ces derniers possédaient également leur propre escalier, au sommet duquel se trouvait l'empereur du Saint Empire romain germanique (couvrant principalement le territoire de l'Allemagne moderne). Cependant, en parallèle, il y avait un clergé qui agissait au nom de Dieu. Son chef était le Pape. Le pouvoir politique de ce dernier s'étendait sur la quasi-totalité de l'Italie fragmentée.
Le conflit entre deux classes de la société et deux titres pour le droit de domination s'est poursuivi pendant plusieurs décennies. Il s’agissait essentiellement d’un débat sur le type d’État – laïc ou théocratique.
Finalement, le clergé catholique vainquit le pouvoir impérial, mais sa suprématie ne dura pas aussi longtemps. Avec le début de la Renaissance et le développement de la science, un mouvement protestant apparaît dans le christianisme, niant la primauté du Pape et l'idée théocratique de l'Europe (le mouvement de Réforme). Après trente ans de guerre, ils couvraient la moitié du continent. La théocratie a alors perdu sa chance de devenir la base du pouvoir en Europe.

Théocratie en Russie
Lorsque notre pays était une monarchie, le prince ou le roi était considéré comme le vice-gérant de Dieu (l'oint). Parallèlement, il y avait le titre de patriarche, qui fut ensuite remplacé par le Synode, subordonné aux autorités. Ainsi, le dirigeant russe contrôlait l’Église, même si ce n’était pas directement.
Au XIXe siècle, la forme politique de gouvernement existante a été critiquée par de nombreux penseurs et écrivains. Par exemple, l'Église a été critiquée par Léon Tolstoï, pour laquelle il a même été excommunié du troupeau. Mais il a proposé d’unir les institutions catholiques et orthodoxes. Cela signifierait l’émergence d’une théocratie chrétienne mondiale. Il réunirait les deux plus grands troupeaux du monde, divisés depuis 1054.
Avec l’avènement du pouvoir soviétique, la sécularisation et la séparation de l’Église de l’État se sont produites. La Fédération de Russie moderne est un État laïc où règne la liberté de religion et où aucune organisation religieuse ne jouit d’un statut exclusif.
C’est V. Soloviev qui a posé et développé le problème, communément désigné depuis par l’expression « idée russe ». En mai 1888 Il a donné une conférence en français à Paris intitulée « L'idée russe ». Le penseur y posait une question qu’il considérait comme extrêmement importante : la question du sens de l’existence de la Russie dans l’histoire du monde. La réponse à cette question était « l’idée russe » formulée par l’auteur. Soloviev croyait que chaque nation, unie par une unité d'État correspondante, est appelée à remplir une certaine mission ou un certain rôle au sein de l'humanité. La mission, ou le rôle, d’une nation en tant que partie du monde entier est l’idée nationale.
L’idée nationale ne découle pas directement des conditions matérielles de l’existence de la Russie. L'idée nationale est une tâche confiée par Dieu, le devoir du peuple envers Dieu. Soloviev écrit : « L'idée d'une nation n'est pas ce qu'elle pense elle-même d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu pense d'elle et de l'éternité. Pour Soloviev, toutes les nations sont des membres et des éléments de l’humanité en tant qu’organisme social, mais en même temps elles sont des « êtres moraux ». De plus, Soloviev estime que dans ce monde moral, il existe une nécessité fatale. Il écrit : « La vocation ou cette idée particulière que la pensée de Dieu pose à tout être moral – individu ou nation – et qui se révèle à la conscience de cet être comme un devoir suprême – cette idée agit dans tous les cas comme une puissance réelle. , elle détermine l’existence d’un être moral, mais elle le fait de deux manières opposées : elle se manifeste comme loi de la vie lorsque le devoir est accompli, et comme loi de la mort lorsque celui-ci n’a pas eu lieu.
Comment déterminer l’essence de l’idée nationale ? Qui parlera au peuple de son devoir ? Après tout, les gens peuvent se tromper sur leur vocation. Il est nécessaire d'analyser toute l'histoire de l'État russe depuis sa création jusqu'à nos jours, d'analyser les moments du développement de la civilisation chrétienne auxquels la Russie a apporté une petite contribution et, sur cette base, de déterminer sa mission dans le futur. L’idée russe, ou la mission historique de la Russie, est de devenir l’initiatrice de la création d’une communauté européenne de pays fondée sur les valeurs chrétiennes, de la création d’une théocratie.
L'élaboration du projet utopique d'une théocratie mondiale est réalisée par Soloviev dans de nombreux ouvrages des années 80 - « L'histoire et l'avenir de la théocratie », « La Russie et l'Église universelle », « La Grande controverse et la politique chrétienne ».
La théocratie mondiale apparaît chez Soloviev comme une forme sociale de Dieu-humanité, reflétant le principe de la trinité du Divin. Les trois hypostases – Père, Fils et Saint-Esprit – sont projetées respectivement dans l'activité humaine comme trois « ministères » : le sacerdoce, le royaume et la prophétie. La question se pose de savoir comment ces trois ministères sont répartis dans la véritable histoire humaine. Soloviev reconnaît sans hésitation les fonctions du grand sacerdoce en tant que pape. Il doute qu'il incombe à Byzance d'incarner l'élément royal de la théocratie. Le césarisme byzantin n'a pas réussi à faire face à ce service et la tâche de créer une société juste a subi un effondrement décisif à Byzance. Mais la «troisième Rome» convient au service du tsar - la Russie en tant qu'héritière de Byzance. Le peuple, qui est porteur de la troisième force, doit être libre de toute limitation et s'élever au-dessus des intérêts nationaux étroits. Ces propriétés, selon Soloviev, sont particulièrement inhérentes au caractère national du peuple russe. En effet, les idéaux du peuple russe sont de nature religieuse, ils sont capables de combiner les cultures orientale et occidentale (comme le prouvent les réformes de Pierre 1), ils ont une capacité innée d'abnégation, ce qui est confirmé par l'invitation des Varègues pour régner en 862.
La situation du ministère prophétique est bien pire dans le monde chrétien. Il est apparu initialement sous la forme du protestantisme qui, né du conflit entre Rome et Constantinople, a considérablement déformé ce troisième principe théocratique : ayant séparé la prophétie du sacerdoce, il n'a pas donné au monde de vrais prophètes. Pour le ministère prophétique, il trouve un substitut en la personne du judaïsme orthodoxe (« judéité »), car ce dernier a une conception de la vocation prophétique qui coïncide avec la vocation véritablement chrétienne et que le protestantisme lui-même est, dans une certaine mesure, , un retour au judaïsme.
Selon Soloviev, la théocratie universelle doit être une théocratie libre : l'unification des nations se fait sur une base volontaire. Dans une société théocratique, toute contrainte à la foi était exclue, en cela elle différait radicalement du Moyen Âge, lorsque l'Église autorisait la persécution cruelle des dissidents. Et Soloviev a sévèrement critiqué l’Église orthodoxe russe pour sa volonté de s’appuyer sur le pouvoir de l’État pour propager artificiellement la foi. Il a ironiquement qualifié le système actuel en Russie de « pseudo-théocratie », dirigée par un triumvirat malveillant composé du faux ecclésiastique Pobedonostsev, du faux homme d’État D. A. Tolstoï et du faux prophète Katkov.
Soloviev a déclaré directement que seule l'Église catholique garantirait l'indépendance des autorités ecclésiales face à l'État et à la société. Quant à l’Église orthodoxe russe, elle s’est depuis longtemps transformée en un instrument obéissant du pouvoir mondain et rejette l’unité des confessions chrétiennes. La première étape que la Russie doit franchir est d’accomplir l’exploit du renoncement national, de sacrifier son égoïsme national. En fait, cela signifiait l’union de l’Église russe avec l’Église catholique, qui pouvait être directement réalisée par la subordination de l’État russe au grand prêtre romain. Le nouvel ordre mondial sera soutenu par le pouvoir d’État du monarque russe, et la paix et la bénédiction entreront dans la famille des peuples chrétiens.
Ainsi, pour que l’idée nationale puisse être mise en pratique, certaines conditions préalables sont nécessaires. Premièrement, il faut garantir le respect des libertés civiles – liberté d’expression, liberté de conscience. Deuxièmement, l’Église orthodoxe russe doit être transformée : sa subordination à l’État et son hostilité à l’égard du christianisme occidental doivent être surmontées.
Soloviev croyait qu'avec la création d'une théocratie universelle, la Russie introduirait envers les peuples européens des éléments de cordialité et de spontanéité qui avaient été perdus par l'Occident rationnel. D’un autre côté, la coopération avec l’Occident aidera à surmonter les tendances barbares et nihilistes caractéristiques de la Russie et contribuera ainsi à l’entrée de la Russie sur la voie des véritables Lumières et du progrès. Pour la Russie, ce projet est également important car, étant à la frontière de deux mondes, il subit une pression constante de la part de l’Est asiatique. L'union avec les pays européens permettrait à la Russie de s'intégrer plus étroitement dans la communauté des pays chrétiens, ce qui constituerait une ferme garantie de la préservation des fondements chrétiens de la culture russe.
Certains chercheurs pensent que vers la fin de la vie de Soloviev, il a subi une grave déception quant au destin messianique de la Russie et de la théocratie mondiale, et que la réaction à cette déception a été l'essai mourant du philosophe « Trois conversations » avec le « Conte de l'Antéchrist ». » inclus dedans. Ainsi, E. N. Troubetskoy affirme que, dans des doutes douloureux, Soloviev en vient à comprendre la terrible vérité selon laquelle le mal universel, dans la lutte avec le bien, prend l'apparence du bien et séduit ainsi les inexpérimentés. L’Antéchrist, dans le récit final des « Trois Conversations », apparaît sous la forme d’un génie, d’une beauté et d’une noblesse exceptionnelles, avec les plus hautes manifestations d’altruisme et de charité active. S'opposant au Christ, il déclare : « Le Christ a apporté l'épée, j'apporterai la paix. Il a menacé la terre d'un jugement terrible, mais je serai le dernier juge, et mon jugement ne sera pas seulement un tribunal de justice, mais un tribunal de miséricorde.
Les actions de l'Antéchrist, comme l'a noté à juste titre E. Trubetskoy, parodient largement les idées précédentes de l'auteur de l'histoire. L'Antéchrist crée la théocratie dont rêvait Soloviev, mais sans Christ, sans amour, basée sur la suppression du libre arbitre de l'homme vers le bien et sur la tentation de sa flatterie. La situation semble vraiment paradoxale. Expliquant le sens de ce paradoxe, E. Trubetskoy dit que Soloviev dans « Trois conversations » s'est rendu compte de la fausseté de l'idée de théocratie et y a renoncé. Il a consacré son article « L’effondrement de la théocratie dans les œuvres de Soloviev » à la preuve de cette affirmation.
Il semble qu’un ouvrage qui s’est avéré être le dernier ne donne pas encore de raison de parler de l’abandon complet par Soloviev de presque tout ce qui a été pensé et écrit. Et la position d’A.F. semble plus convaincante pour évaluer cette question. Loseva. D’une part, comme E. Troubetskoy, il estime que la « déification » de l’État est l’une des idées les plus significatives de Soloviev. Mais en même temps, il conteste son appréciation des idées théocratiques de Soloviev et écrit : « Il n’est en aucun cas impossible de dire qu’il s’éloigne complètement de ses idées théocratiques. Sa déception porte plutôt sur la possibilité d'une réalisation immédiate et plus profonde de l'idéal théocratique. Bien entendu, cet idéal lui-même reste intact en lui.
Ainsi, l’effondrement de la théocratie de Soloviev devrait apparemment être compris comme sa non-incarnation historique. De plus, le caractère risqué du projet théocratique n'a pas été ressenti par Soloviev seulement au cours des dernières années de sa vie. C’est pourquoi dans sa logique de réflexion sur la théocratie, il y a nécessairement un horizon d’« obligation morale » ou de devoir. Le sort de la Russie dépend de l’incarnation du visage iconographique de Sophie sous la forme de la théocratie. En cas de non-respect de ce devoir, la Russie elle-même pourrait être écrasée : dans un monde de nécessité morale, le non-respect du projet de Dieu pour le peuple est passible de la peine de mort.
Dans ses réflexions sur « l’idée russe », il résume toute l’expérience de la pensée russe du XIXe siècle. Grâce à ses efforts de synthèse, la Russie ne se trouve plus à la fin de la véritable histoire, mais à son début. Avec lui, avec sa transformation théocratique, surmontant la discorde du monde, la confrontation hostile des confessions chrétiennes, et de l'Orient et de l'Occident en tant que tels, peut commencer.
Théocratie
THÉOCRATIE
(théocratie) Littéralement « la puissance de Dieu ». Le terme a été inventé par Josèphe (38 – vers 100 après JC) pour décrire le régime politique hébreu et le rôle des lois de Moïse. Cependant, si vous ne croyez pas que ces Lois ont été descendues par Dieu sur des tablettes de pierre, il vous sera difficile d'amener la théocratie dans les conditions proposées par les théocrates eux-mêmes. Le sens plus laïc du terme vient du fait que la théocratie est précisément un gouvernement. Cependant, on peut également faire valoir qu'il est plus important de prendre en compte la différence entre un régime politique fondé sur des lois révélées, auquel ni le peuple ni le monarque héréditaire ne peuvent résister, et un régime qui n'a pas de telles lois et ne suis les. Il convient de noter que même les régimes qui prétendent que leurs lois sont ordonnées par Dieu et donc immuables n’étendent pas cette affirmation à toutes les lois sans exception. La charia musulmane, par exemple, reconnaît l'existence d'un droit positif Moubah(mubah), portant sur des questions telles que l'obligation de conduire à droite, qui sont neutres au sens religieux. ( voir également: Fondamentalisme islamique - Fondamentalisme islamique, Sommisme - Sunnisme, Chiisme - Chiisme). Les théocraties typiques comprennent les Dalaï Lamas tibétains, les États pontificaux et la Genève calviniste. Cependant, certains éléments de théocratie sont également présents dans certains États modernes, notamment dans le monde musulman. Les dirigeants du Pakistan, de l’Arabie Saoudite et de l’Iran affirment respecter la charia. Le régime iranien correspond le mieux à la définition d’une théocratie, dans laquelle les experts religieux en droit divin jouissent d’une réelle influence politique. L’ayatollah Khomeini, qui a dirigé la révolution islamique de 1979, a préconisé la construction d’un État laïc limité par une « tutelle théocratique » afin que sa ligne politique ne dépasse pas le cadre de la loi divine. Des manifestations individuelles de théocratie chrétienne ont eu lieu en Géorgie pendant le mandat de Zviad Gamsakhourdia en 1990-1992. Avant d'être démis du pouvoir, Gamsakhourdia s'est prononcé en faveur de la création d'une deuxième chambre du Parlement, composée du clergé.
Politique. Dictionnaire. - M. : "INFRA-M", Maison d'édition "Ves Mir". D. Underhill, S. Barrett, P. Burnell, P. Burnham, etc. Rédacteur général : Docteur en économie. Osadchaya I.M.. 2001 .
Théocratie
(du grec theos - dieu, kratos - pouvoir) - une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique est entre les mains du chef de l'église, le clergé. La théocratie existait aux Ve-Ier siècles. avant JC e. en Judée, où le pouvoir appartenait au grand prêtre. Les États théocratiques étaient les califats des Omeyyades, des Abbassides et des États pontificaux au Moyen Âge, où le pape exerçait le pouvoir spirituel et politique.
Le Vatican moderne est un État théocratique occupant une superficie de 44 hectares. Il est né en 1929. Le chef du Vatican, le pape, dispose du pouvoir illimité du monarque. Les affaires administratives du Vatican sont gérées par une commission de cardinaux et un gouverneur nommé par le pape. Les affaires ecclésiastiques et politiques sont gérées par la Curie romaine (gouvernement). Le chef de la curie (premier ministre) est considéré comme le cardinal secrétaire d'État, qui est également le ministre des Affaires étrangères chargé de la politique étrangère.
Sous le pape, il existe un organe consultatif - le synode de l'Église, convoqué périodiquement, qui comprend les plus hautes personnalités religieuses des églises catholiques, des ordres monastiques et d'autres personnes.
Le Vatican dispose d'un corps diplomatique qui comprend des représentants de 125 pays. Le Vatican est représenté à l'ONU. Les valeurs théocratiques du Vatican jouent un rôle important dans les pays de religion catholique, dans lesquels la réglementation religieuse de tous les aspects de la vie personnelle et publique est renforcée. On ne peut donc pas dire que la théocratie soit un anachronisme, une forme de gouvernement et une idéologie qui ont quitté l’arène de l’histoire. Certains événements modernes, par exemple la révolution « islamique » en Iran, ont montré encore aujourd’hui la présence de tendances théocratiques.
Science politique. Dictionnaire. -M : RSU. V.N. Konovalov. 2010.
Théocratie
(depuis grec Théos Dieu)
une forme de gouvernement dans laquelle le chef d'un État (généralement une monarchie) est également son chef religieux.
Science politique : dictionnaire-ouvrage de référence. comp. Professeur Science Sanzharevsky I.I.. 2010 .
Science politique. Dictionnaire. - USR. V.N. Konovalov. 2010.
Synonymes:Voyez ce qu’est « Théocratie » dans d’autres dictionnaires :
- (du grec theokratia, de Theos Dieu, au pouvoir kratos). La Seigneurie de Dieu. La règle du spirituel, en tant que serviteurs directs ou vice-gérants de Dieu ; une combinaison de pouvoir civil et spirituel en une seule personne. Dictionnaire de mots étrangers inclus dans... ... Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe
théocratie- et, f. gr.théocratie f. gr. pouvoir théos + kratos. 1. Une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique appartient au clergé et aux prêtres. Ouais. 1940. Autocratie prétorienne, théocratie papale... tous ces phénomènes nous sont familiers par expérience. Proudhon... ... Dictionnaire historique des gallicismes de la langue russe
THÉOCRATIE, une combinaison de pouvoir civil et spirituel en une seule personne. Dictionnaire explicatif de Dahl. DANS ET. Dahl. 1863 1866… Dictionnaire explicatif de Dahl
THÉOCRATIE- (du grec theos dieu et kratos pouvoir) une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est concentré entre les mains du clergé ou du chef de l'église. Les États théocratiques existent depuis l’Antiquité. Le Pape est le plus haut dirigeant de l’Église catholique romaine... ... Encyclopédie juridique
- (du grec theos dieu et...cratie), forme de gouvernement dans laquelle le chef de l'Etat est aussi son chef religieux... Encyclopédie moderne
- (du grec theos dieu et...cratie) une forme de gouvernement dans laquelle le chef de l'État (généralement monarchique) est aussi son chef religieux... Grand dictionnaire encyclopédique
Une forme de gouvernement dans laquelle le chef de l'Etat est aussi le chef religieux... Dictionnaire historique
- [théocratie], théocratie, femme. (du grec theos dieu et krateo j'ai le pouvoir) (livre). 1. unités uniquement Forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique appartient au clergé et aux prêtres. 2. Un État avec cette forme de gouvernement. Théocraties de l'Antiquité... ... Dictionnaire explicatif d'Ouchakov
THÉOCRATIE, et, femme. Forme de gouvernement dans laquelle le chef du clergé ou de l'Église est le chef de l'État. | adj. théocratique, oh, oh. Dictionnaire explicatif d'Ojegov. SI. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949 1992… Dictionnaire explicatif d'Ojegov
- (du grec the6s - Dieu et krätos - pouvoir, pouvoir divin) une forme de gouvernement, dans laquelle le pouvoir séculier est entre les mains de la double hiérarchie, l'Église par exemple. dans l'Egypte ancienne, en Judée, à l'époque catholique. Moyen-âge. Fondé sur la théocratie... Encyclopédie philosophique
Livres
- Théocratie. Fantôme ou réalité ? , Zh. T. Tochtchenko. Des guerres de religion arrivent-elles ? Pourquoi les ecclésiastiques revendiquent-ils le pouvoir ou y participent-ils ? Pourquoi des partis et mouvements religieux et politiques se forment-ils ? Est-il possible que...